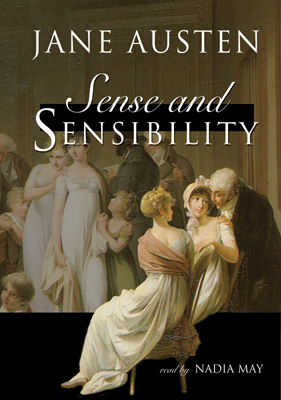 L’idée de ce titre m’est venue alors que l’on vient de me proposer ma trente-deuxième traduction qui promet de me faire relever tous les défis, et me porte à croire qu’un traducteur littéraire, s’il veut travailler, doit vraiment savoir tout faire, ou plutôt tout traduire, être d’une polyvalence intellectuelle pour le moins élastique !
L’idée de ce titre m’est venue alors que l’on vient de me proposer ma trente-deuxième traduction qui promet de me faire relever tous les défis, et me porte à croire qu’un traducteur littéraire, s’il veut travailler, doit vraiment savoir tout faire, ou plutôt tout traduire, être d’une polyvalence intellectuelle pour le moins élastique !
J’ai traduit en son temps un Irlandais déjanté (Aidan Mathews) qui cachait des citations de Shakespeare détournées à chaque coin de page, une Galloise (Trezza Azzopardi) au style métaphorique pour le moins personnel, une Irlandaise (Anne Enright) dont la créativité linguistique m’avait donné bien du fil à retordre, et alors que je croyais avoir tout connu, voilà que l’on me propose un texte situé en… 1683, ce qui est pour le moins inhabituel pour la traductrice très contemporaine que je suis ; la preuve étant qu’après une difficile expérience avec Franck O’Connor, début XXe, je refuse de traduire des auteurs décédés. Il me faut pouvoir leur poser des questions !
Dieu merci, cet auteur-ci est vivant ! Seul hic, elle se pique de parler français et souhaitera relire la traduction une fois terminée, le pire des cas de figure ! Nadine Gordimer a ainsi épuisé nombre de ses traducteurs en français…
L’anglais utilisé dans ledit texte ne date bienheureusement pas du XVIIe , mais il est au bas mot très proche d’un anglais raffiné et austère du XIXe (pensez Jane Austen), dont le classicisme altier… m’impressionne, jugez plutôt : I was taking my habitual mid-day dinner, ou bien Will, attempting a dispersal of the dust, ou encore a thing purloined etc.
La philosophie de l’éditrice qui m’a contactée est qu’elle ne veut pas d’américanistes « relâchés » pour s’attaquer à un tel monument, et qu’elle se souvenait que j’avais traduit pour elle « autrefois » (cela remonte à il y a dix années de cela) des textes très littéraires et très difficiles. Si j’avais pu m’en acquitter très honorablement à l’époque (un de ces textes avait été sélectionné pour un prix de traduction), je devais pouvoir m’en acquitter très honorablement une nouvelle fois, en dépit du contexte différent et du niveau de langue très soutenu qu’il va falloir rendre de manière aussi soutenue en français, ce qui n’est pas vraiment ma spécialité mais soit, adaptons-nous.
Sauf que depuis mes débuts littéraires spécialisés en textes difficiles je n’ai traduit que des textes faciles, grand public et autres best-sellers… (cherchez l’erreur, le contraire eut tout de même été plus facile ! )
J’avoue donc avoir quelque peu hésité.Puis je me suis dit que je relirais bien Hardy et Austen, pour m’assurer que le texte était bien dans ce ton-là (l’éditrice a beaucoup insisté sur la difficulté du ton à rendre), après quoi, bien plus important, je relirai Flaubert et Stendhal pour me couler dans le moule lexical et stylistique de l’époque, tout en l’adaptant bien sûr au style particulier de cet écrivaine anglaise.
Pour finir j’ai surtout béni mes cours classiques d’angliciste distinguée qui m’ont valu d’être déjà à plusieurs reprises confrontée à ce style d’anglais pour le moins… désuet… et donc de le comprendre ! – ce qui ne serait pas le cas de quelqu’un qui aurait appris la langue dans le pays, par exemple.
Du coup me voici qui révise un avis que j’ai pu donner ailleurs sur ce site comme quoi il n’était pas vital d’avoir fait des études ad hoc mais bien d’avoir vécu dans le pays… Eh bien, si l’on souhaite « tourner », force m’est d’admettre qu’avoir fait des études d’anglais ne nuit pas, que nenni. Dans le cas présent c’est en tout cas un plus. Qui me laisse songeuse face à tous les grands écarts que j’ai pu effectuer dans ce métier : des Irlandais déjantés aux Américains béni-oui-oui, des Anglais sulfureux aux Anglais précieux, des Canadiennes cuculs aux Américains farceurs, rien ne m’aura été épargné.
Avec à chaque fois une nouvelle casaque à endosser, un nouvel habit à enfiler, de nouveaux atours, pour une nouvelle langue, une nouvelle culture, une narration plus ou moins stylée, à laquelle à chaque fois il faudra se plier afin d’être le moins infidèle possible.
Alors le traducteur, pervers polymorphe ?
Aussi plaisant que soit le tour de phrase, disons plutôt performeur polymorphe !
Et allons même jusqu’à équilibriste !
Alors, en piste !
Et à la semaine prochaine pour de nouveaux questionnements. Et guettez la rubrique spéciale qui, dans cette newsletter ou ailleurs sur le site, vous tiendra au courant au plus près des avancements de cette nouvelle traduction promettant d’être un joli défi !
N’oubliez pas qu’entre-temps les vôtres m’intéressent aussi !
Merci pour ces quelques lignes partagées, Hélène ! « Quand on traduit on ne ré-écrit pas l’histoire d’un autre… », dites-vous. C’est pourtant bien d’écriture et de ré-écriture qu’il s’agit, à mes yeux en tout cas, avec le moins d’infidélités possible, ce qui n’est pas un mince effort ! Ecrire c’est ré-écrire, et traduire c’est peut-être bien ré-écrire aussi, avec de nouveaux mots, d’une autre langue, dans l’alchimie qu’il y a à transformer l’or en plomb (restons humble ;-)).
Je traduis de l’anglais au français et l’idéal est sans doute de traduire un auteur vivant car une fois que l’on a compris une oeuvre (ce qui est déjà un travail important selon sa difficulté), il faut pouvoir interroger l’auteur pour comprendre sa démarche et ce qu’il a voulu exprimer.
Le dilemme du traducteur est de rester fidèle au texte de départ tout en trouvant un équivalent dans la langue d’arrivée qui colle aux intentions premières de l’auteur.
Certains traducteurs pensent qu’un auteur est souvent un mauvais traducteur. Je ne le pense pas. La traduction est différente de l’écriture, c’est tout et quand on traduit, on ne ré-écrit pas l’histoire d’un autre, mais cela demande de l’expérience, il est vrai.