 Pour qui fréquente un tant soit peu le milieu de la traduction littéraire, Françoise Wuilmart est une traductrice, que dis-je, une sommité que l’on ne présente (presque) plus ! Tour à tour enseignante, traductrice, critique, essayiste, elle a fondé le CETL et le D.E.S.S. en traduction littéraire à l’ISTI (actuellement Master pro), et son œuvre de traductrice a été récompensée par de nombreux prix (Prix Ernst-Bloch, Prix Aristeion et Prix Gérard de Nerval).
Pour qui fréquente un tant soit peu le milieu de la traduction littéraire, Françoise Wuilmart est une traductrice, que dis-je, une sommité que l’on ne présente (presque) plus ! Tour à tour enseignante, traductrice, critique, essayiste, elle a fondé le CETL et le D.E.S.S. en traduction littéraire à l’ISTI (actuellement Master pro), et son œuvre de traductrice a été récompensée par de nombreux prix (Prix Ernst-Bloch, Prix Aristeion et Prix Gérard de Nerval).
Plutôt que de me pencher plus en détails sur cet impressionnant parcours, que l’on retrouvera ici, j’ai préféré lui poser de petites questions toutes simples sur la traduction littéraire et les enseignements qui en découlent.
1- Françoise, tu traduis de l’anglais et du néerlandais, mais essentiellement de l’allemand, me semble-t-il. Qu’est-ce qui t’a poussée vers cette langue ? Une lecture, un voyage, un engouement d’une autre nature ? A moins que tu les aimes toutes à parts égales ?
Très difficile de répondre à ce genre de question presque intime d’autant que l’on n’a pas nécessairement conscience soi-même des motivations profondes et réelles. Peut-être dois-je retourner à mon enfance, et à ce grand-père qui aimait la langue de Goethe et voulait me faire partager l’amour d’une forme de grandeur dans l’allemand. Ce grand-père qui faisait parfois l’interprète pendant la guerre, tout résistant qu’il soit. C’est peut-être lui qui m’a encore influencée quand j’ai dû choisir au lycée entre l’allemand et l’espagnol. Quoi qu’il en soit, la sonorité de l’allemand m’a toujours plu, pour le dire simplement : j’ai toujours aimé entendre cet idiome même sans le comprendre. Comme si j’en pressentais, rien que par la sonorité, la logique et la clarté. En étudiant l’allemand, je l’aimais de plus en plus, et me sentais pour ainsi dire chez moi dans sa grammaire, dans sa syntaxe, dans la souplesse infinie de son vocabulaire, dans son immense potentiel créatif.
n’a pas nécessairement conscience soi-même des motivations profondes et réelles. Peut-être dois-je retourner à mon enfance, et à ce grand-père qui aimait la langue de Goethe et voulait me faire partager l’amour d’une forme de grandeur dans l’allemand. Ce grand-père qui faisait parfois l’interprète pendant la guerre, tout résistant qu’il soit. C’est peut-être lui qui m’a encore influencée quand j’ai dû choisir au lycée entre l’allemand et l’espagnol. Quoi qu’il en soit, la sonorité de l’allemand m’a toujours plu, pour le dire simplement : j’ai toujours aimé entendre cet idiome même sans le comprendre. Comme si j’en pressentais, rien que par la sonorité, la logique et la clarté. En étudiant l’allemand, je l’aimais de plus en plus, et me sentais pour ainsi dire chez moi dans sa grammaire, dans sa syntaxe, dans la souplesse infinie de son vocabulaire, dans son immense potentiel créatif.
2- Qu’est-ce qui t’a orientée vers la traduction ensuite ? Une autre volonté de partage, de transmission peut-être, qui complèterait celle de ta carrière d’enseignante ?
 Je n’ai jamais oublié cet incident révélateur sans doute, dans ma petite enfance. Une amie de classe était absente ce jour-là et l’institutrice m’avait déléguée en émissaire auprès d’elle. L’amie n’était pas malade, mais disons découragée, triste, et j’ai senti que les mots que je lui adresserais pour la consoler et la ramener à l’école étaient d’une importance capitale. C’est là que pour la première fois j’ai été interprète d’un côté puis de l’autre et que j’ai compris tout le poids d’une telle médiation. Par la suite je me suis souvent retrouvée dans ce rôle qui ne me déplaisait pas. Il y a aussi le fait que j’étais musicienne ; j’ai appris le piano dès l’âge de cinq ans, sensibilisée très tôt donc aux sons, à la mélodie, dont l’importance communicative se retrouve dans le phrasé littéraire.
Je n’ai jamais oublié cet incident révélateur sans doute, dans ma petite enfance. Une amie de classe était absente ce jour-là et l’institutrice m’avait déléguée en émissaire auprès d’elle. L’amie n’était pas malade, mais disons découragée, triste, et j’ai senti que les mots que je lui adresserais pour la consoler et la ramener à l’école étaient d’une importance capitale. C’est là que pour la première fois j’ai été interprète d’un côté puis de l’autre et que j’ai compris tout le poids d’une telle médiation. Par la suite je me suis souvent retrouvée dans ce rôle qui ne me déplaisait pas. Il y a aussi le fait que j’étais musicienne ; j’ai appris le piano dès l’âge de cinq ans, sensibilisée très tôt donc aux sons, à la mélodie, dont l’importance communicative se retrouve dans le phrasé littéraire.
3- Comment en es-tu venue à la traduction ? Tu es connue pour ta traduction du Principe Espérance d’Ernst Bloch qui t’a valu un prix et, en Belgique, une Notoriété scientifique et professionnelle. Que représente ce travail pour toi ?
En réalité je n’ai jamais voulu être traductrice, du moins pas consciemment. C’est le hasard qui a guidé mes pas. J’ai pourtant eu la formation idéale, bien qu’indirecte : étudiante en philosophie et lettres, section langues germaniques, j’ai, durant des années, lu, écrit plus qu’il n’en faut. Et j’avais incontestablement un certain talent d’écriture, comme me le répétaient mes professeurs. Il se fait que j’aimais aussi la philosophie et assistais régulièrement à des séminaires de philosophie. C’est à l’un d’eux (Lucien Goldman) qu’un assistant de philosophie, Pierre Verstraeten, m’a approchée : il était aussi directeur de collection chez Gallimard, et voulait faire traduire l’œuvre majeure du philosophe allemand Ernst Bloch. Il avait contacté mon professeur Henri Plard qui, occupé à traduire Ernst Jünger, ne pouvait accepter. Mon professeur m’avait donc recommandée et j’en fus très flattée. Il fallait d’abord que je sache si l’ouvrage me plaisait, j’eus donc dès le départ le bon réflexe de la nécessaire empathie. Et le livre aussitôt me séduisit. Je fis un essai de quelque 30 pages (cela me prit six mois tant le texte était difficile et exigeant dans les recherches). J’eus l’heur de plaire aux lecteurs de Gallimard et montai à Paris pour signer le contrat. D’un travail qui allait me prendre plus de 20 ans pour quelque 3000 pages. Précisons toutefois que parallèlement j’élevais deux enfants et assurais des cours de langue dans le secondaire puis dans le supérieur. Quand j’eus terminé de traduire le Principe Espérance, le virus était bien installé en moi et j’ai poursuivi avec d’autres auteurs.
le hasard qui a guidé mes pas. J’ai pourtant eu la formation idéale, bien qu’indirecte : étudiante en philosophie et lettres, section langues germaniques, j’ai, durant des années, lu, écrit plus qu’il n’en faut. Et j’avais incontestablement un certain talent d’écriture, comme me le répétaient mes professeurs. Il se fait que j’aimais aussi la philosophie et assistais régulièrement à des séminaires de philosophie. C’est à l’un d’eux (Lucien Goldman) qu’un assistant de philosophie, Pierre Verstraeten, m’a approchée : il était aussi directeur de collection chez Gallimard, et voulait faire traduire l’œuvre majeure du philosophe allemand Ernst Bloch. Il avait contacté mon professeur Henri Plard qui, occupé à traduire Ernst Jünger, ne pouvait accepter. Mon professeur m’avait donc recommandée et j’en fus très flattée. Il fallait d’abord que je sache si l’ouvrage me plaisait, j’eus donc dès le départ le bon réflexe de la nécessaire empathie. Et le livre aussitôt me séduisit. Je fis un essai de quelque 30 pages (cela me prit six mois tant le texte était difficile et exigeant dans les recherches). J’eus l’heur de plaire aux lecteurs de Gallimard et montai à Paris pour signer le contrat. D’un travail qui allait me prendre plus de 20 ans pour quelque 3000 pages. Précisons toutefois que parallèlement j’élevais deux enfants et assurais des cours de langue dans le secondaire puis dans le supérieur. Quand j’eus terminé de traduire le Principe Espérance, le virus était bien installé en moi et j’ai poursuivi avec d’autres auteurs.
4-Personnellement, je suis intriguée par ta traduction de ce magnifique récit (anonyme) qu’est Une Femme à Berlin. Est-ce toi qui as découvert cet ouvrage, si oui comment, ou bien on te l’a proposé ?
 Non ce n’est pas moi qui l’ai découvert, j’ai été contactée par Pierre Nora, directeur de la collection Témoins chez Gallimard. Dès les premières pages naquit en moi cette fois encore une réelle empathie avec le texte. Je me sentais à même de restituer, d’entonner la voix de la diariste, en route donc pour cette nouvelle aventure…
Non ce n’est pas moi qui l’ai découvert, j’ai été contactée par Pierre Nora, directeur de la collection Témoins chez Gallimard. Dès les premières pages naquit en moi cette fois encore une réelle empathie avec le texte. Je me sentais à même de restituer, d’entonner la voix de la diariste, en route donc pour cette nouvelle aventure…
5- Y avait-il des difficultés particulières à traduire un auteur dont on ne sait rien et que l’on ne peut interroger sur rien non plus ?
C’est un peu comme si on demandait au lecteur s’il a besoin de connaître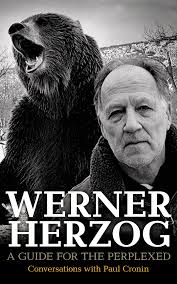 l’écrivain pour mieux apprécier son texte. Un texte bien écrit parle pour lui-même et point n’est besoin d’en consulter l’auteur. « Ce que j’ai voulu dire est tel que c’est là et je ne pourrais le dire autrement », répondit un jour un grand réalisateur allemand (Werner Herzog) à qui l’on demandait justement ce qu’il avait voulu dire par son film. Il y a certes la question des realia, mais point n’est besoin de l’auteur pour trouver les réponses.
l’écrivain pour mieux apprécier son texte. Un texte bien écrit parle pour lui-même et point n’est besoin d’en consulter l’auteur. « Ce que j’ai voulu dire est tel que c’est là et je ne pourrais le dire autrement », répondit un jour un grand réalisateur allemand (Werner Herzog) à qui l’on demandait justement ce qu’il avait voulu dire par son film. Il y a certes la question des realia, mais point n’est besoin de l’auteur pour trouver les réponses.
6- A l’autre extrémité, tu t’es attaquée à la retraduction de neuf nouvelles de Zweig. Leur traduction avait vieilli ? Ou as-tu espéré braquer sur elles un nouvel éclairage, une nouvelle sensibilité ?
 Certes, on peut dire que les traductions de Zweig avaient vieilli, mais plus grave encore : outre des omissions récurrentes, une certaine censure aussi, le style de Zweig n’était pas respecté. Zweig a une écriture rapide, enlevée, mais très épidermique, émotive et sensuelle, presque féminine, à certains moments même hystérique. Ce à quoi les traductions existantes ne rendaient absolument pas justice.
Certes, on peut dire que les traductions de Zweig avaient vieilli, mais plus grave encore : outre des omissions récurrentes, une certaine censure aussi, le style de Zweig n’était pas respecté. Zweig a une écriture rapide, enlevée, mais très épidermique, émotive et sensuelle, presque féminine, à certains moments même hystérique. Ce à quoi les traductions existantes ne rendaient absolument pas justice.
7- Selon toi, quels sont les critères d’une bonne traduction ?
Mon dieu, quelle immense question… Pour l’essentiel une bonne traduction se doit de créer les mêmes effets que l’original, mais tout est là, le matériau de la langue d’arrivée est parfois tellement différent de celui de la langue source que cela devient presque impossible. La reproduction dans du bois d’une madone de marbre en est-elle une fidèle restitution ? Certes non, la veine du bois a orienté le ciseau du sculpteur et le bois ne fait pas le même effet que le marbre… Et puis il y a le problème de la réception ; le lectorat du sud n’est pas le même que celui du nord, les effets seront donc forcément biaisés…
doit de créer les mêmes effets que l’original, mais tout est là, le matériau de la langue d’arrivée est parfois tellement différent de celui de la langue source que cela devient presque impossible. La reproduction dans du bois d’une madone de marbre en est-elle une fidèle restitution ? Certes non, la veine du bois a orienté le ciseau du sculpteur et le bois ne fait pas le même effet que le marbre… Et puis il y a le problème de la réception ; le lectorat du sud n’est pas le même que celui du nord, les effets seront donc forcément biaisés…
8- Comment traduis-tu, toi, as-tu une méthode particulière, une façon bien à toi de t’approprier un texte étranger ?
 J’ai un principe sacré : je refuse de traduire ma seule lecture particulière du texte ; j’essaie d’en percevoir toute la polysémie et c’est elle que je veux restituer, dans la mesure du possible. Donc, fournir un texte aussi plurivoque et riche que l’original et certainement pas ma lecture à moi, mon ressenti à moi, dans mon style à moi.
J’ai un principe sacré : je refuse de traduire ma seule lecture particulière du texte ; j’essaie d’en percevoir toute la polysémie et c’est elle que je veux restituer, dans la mesure du possible. Donc, fournir un texte aussi plurivoque et riche que l’original et certainement pas ma lecture à moi, mon ressenti à moi, dans mon style à moi.
9- Est-ce cette méthode que tu as transmise à tes étudiants, ou recommandes-tu plutôt à chacun de se forger la sienne ?
Je ne puis répondre, en tout cas j’ai tenté de leur inculquer ce principe fondamental du double respect de la cohérence textuelle et de la lecture multiple.
10- Quelle a été la ligne directrice de tes enseignements ?
Dans mes cours de traduction j’ai toujours fui la théorie et privilégié la pratique. En partant de la base même de toute prise de sens et de toute restitution : ainsi faisais-je lire à haute voix le texte de l’original, phrase par phrase, puis je demandais à l’étudiant de lever les yeux de la page, et de me dire tout simplement avec les mots qui lui venaient à la bouche, ce qu’il avait compris, sans rien oublier. Quand il commençait par « heu et bien… » c‘était un bon départ, il était « authentique ». Très souvent en ayant oublié le libellé du texte étranger, l’étudiant trouvait spontanément les mots justes bien éloignés parfois de l’original. Ensuite, ce n’était plus qu’une question de précision et de style : il fallait restituer le texte à d’autres strates : celle du rythme, de la mélodie, du ton. Il s’agissait ni plus ni moins de la procédure de déverbalisation si chère à l’école de l’ESIT, certes, mais à quoi bon leur bourrer le crâne de théories? Ils la mettaient en pratique en classe, tout seuls.
En partant de la base même de toute prise de sens et de toute restitution : ainsi faisais-je lire à haute voix le texte de l’original, phrase par phrase, puis je demandais à l’étudiant de lever les yeux de la page, et de me dire tout simplement avec les mots qui lui venaient à la bouche, ce qu’il avait compris, sans rien oublier. Quand il commençait par « heu et bien… » c‘était un bon départ, il était « authentique ». Très souvent en ayant oublié le libellé du texte étranger, l’étudiant trouvait spontanément les mots justes bien éloignés parfois de l’original. Ensuite, ce n’était plus qu’une question de précision et de style : il fallait restituer le texte à d’autres strates : celle du rythme, de la mélodie, du ton. Il s’agissait ni plus ni moins de la procédure de déverbalisation si chère à l’école de l’ESIT, certes, mais à quoi bon leur bourrer le crâne de théories? Ils la mettaient en pratique en classe, tout seuls.
Ensuite, je leur faisais comprendre qu’un texte est une texture, et que le respect de la cohérence textuelle est le premier palier d’une bonne traduction, un texte qui n’a ni queue ni tête ne passe pas la rampe et est une « laide infidèle ». Cette cohérence passe par divers relais que nous repérions (les connecteurs par exemple, ou les accents). Et enfin, je leur faisais surligner en diverses couleurs les champs sémantiques d’un texte : ces réseaux de mots qui se font écho et qu’il est impératif de repérer et de reproduire sous peine de massacrer l’intention de l’auteur et d’évacuer l’atmosphère, le ton, et j’en passe.
En gros : mes cours de traduction ont toujours été, je crois, « humains », j’allais chercher dans l’étudiant, dans son cerveau, dans son vécu, voire dans son inconscient ce qui s’y trouvait déjà sans qu’il s’en rendre compte, une sorte de maïeutique donc. On s’amusait beaucoup à ces cours de traduction, c’était chaque fois comme un jeu qui valorisait l’étudiant en apparence le moins doué…
11- Quelle fierté particulière éprouves-tu concernant ton implantation à Seneffe ?
 Ah mais, quand je vois tous ces traducteurs étrangers réunis autour d’une table conviviale où toutes les cultures se frottent l’une à l’autre sans se quereller, je suis fière en effet ! C’est un idéal que j’ai réalisé là : tous ces traducteurs parfois du même auteur qui échangent, comparent, travaillent de concert, tous ces auteurs qui viennent leur rendre visite, donc les découvrent ces travailleurs de l’ombre, et les découvrent avec émotion… Il n’y a pas plus tolérant que le traducteur. Simon Leys a dit que si le monde était peuplé de traducteurs il n’y aurait plus de guerre, il a raison. Car ce qui les caractérise tous c’est cette volonté d’écouter l’Autre dans toute sa différence pour mieux porter sa voix au-delà des frontières. Qui dit mieux ?
Ah mais, quand je vois tous ces traducteurs étrangers réunis autour d’une table conviviale où toutes les cultures se frottent l’une à l’autre sans se quereller, je suis fière en effet ! C’est un idéal que j’ai réalisé là : tous ces traducteurs parfois du même auteur qui échangent, comparent, travaillent de concert, tous ces auteurs qui viennent leur rendre visite, donc les découvrent ces travailleurs de l’ombre, et les découvrent avec émotion… Il n’y a pas plus tolérant que le traducteur. Simon Leys a dit que si le monde était peuplé de traducteurs il n’y aurait plus de guerre, il a raison. Car ce qui les caractérise tous c’est cette volonté d’écouter l’Autre dans toute sa différence pour mieux porter sa voix au-delà des frontières. Qui dit mieux ?
12- Parle-nous un peu de ton enseignement.
Dans les années 80, j’étais professeur de traduction à l’ISTI et une chose me frappait : le nombre élevé de mauvaises traductions sur le marché. La raison semblait claire : le métier était accessible à tout un chacun, aucune formation, aucun filtre pour stopper les « imposteurs » ou les « usurpateurs » (n’ayons pas peur des mots) qui parvenaient à convaincre un éditeur naïf. C’est là que germa en moi l’idée de former le traducteur littéraire Comme on forme un peintre ou un musicien. Au départ une seule exigence : savoir lire, savoir écrire. Il s’agissait ensuite d’enseigner un savoir-faire, et d’employer à cet effet les meilleurs professionnels du métier, les plus grands praticiens. J’ai donc créé une sorte de « conservatoire » non pas de musique mais de traduction littéraire. Le succès fut énorme, comme si tant de personnes l’attendaient depuis longtemps. Aujourd’hui cette école a non seulement des ateliers en présentiel à Bruxelles mais des cours à distance de tout haut niveau.
frappait : le nombre élevé de mauvaises traductions sur le marché. La raison semblait claire : le métier était accessible à tout un chacun, aucune formation, aucun filtre pour stopper les « imposteurs » ou les « usurpateurs » (n’ayons pas peur des mots) qui parvenaient à convaincre un éditeur naïf. C’est là que germa en moi l’idée de former le traducteur littéraire Comme on forme un peintre ou un musicien. Au départ une seule exigence : savoir lire, savoir écrire. Il s’agissait ensuite d’enseigner un savoir-faire, et d’employer à cet effet les meilleurs professionnels du métier, les plus grands praticiens. J’ai donc créé une sorte de « conservatoire » non pas de musique mais de traduction littéraire. Le succès fut énorme, comme si tant de personnes l’attendaient depuis longtemps. Aujourd’hui cette école a non seulement des ateliers en présentiel à Bruxelles mais des cours à distance de tout haut niveau.
13- Parmi tes nombreuses lectures, as-tu une traduction phare, un modèle de traduction ?
 Non, je l’avoue, j’ai appris le métier toute seule et sur le tas, par la trial-and-error-method. Mon maître ce fut Ernst Bloch, ce philosophe poète que je devais traduire dans toutes ses nuances (pendant plus de 3000 pages), il m’a tout appris (sans le savoir !), Le Principe Espérance c’était ma première traduction et j’ai mis 20 ans à l’accomplir.
Non, je l’avoue, j’ai appris le métier toute seule et sur le tas, par la trial-and-error-method. Mon maître ce fut Ernst Bloch, ce philosophe poète que je devais traduire dans toutes ses nuances (pendant plus de 3000 pages), il m’a tout appris (sans le savoir !), Le Principe Espérance c’était ma première traduction et j’ai mis 20 ans à l’accomplir.
14- Et as-tu un livre de chevet, que tu relis encore et toujours ?
Tintin, tous ses albums ! Et puis j’ai des pièces musicales que je ne me lasse pas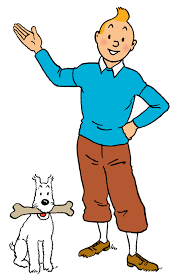 d’écouter…
d’écouter…
15- Qu’aimerais-tu que l’on retienne de ton travail « plus tard » ?
Mais peut-être ma manière d’enseigner la traduction comme je l’expliquais plus haut ? Car je crois que c’est la seule valable et non complexante pour l’apprenant…
16- La littérature aura-t-elle été la grande histoire d’amour de ta vie ?
 Non pas du tout. La grande histoire d’Amour de ma vie c’est la créativité. Pour moi il y a trois sources de vrai bonheur : santé, amour et créativité. Traduire c’est pour moi avant tout créer, même si ce n’est que recréer, et quand je crée, je vis pleinement.
Non pas du tout. La grande histoire d’Amour de ma vie c’est la créativité. Pour moi il y a trois sources de vrai bonheur : santé, amour et créativité. Traduire c’est pour moi avant tout créer, même si ce n’est que recréer, et quand je crée, je vis pleinement.
17 -Tu n’as jamais eu envie d’écrire ?
Mais si, et j’écris aussi… des nouvelles, qui sont toutes publiées et certaines même traduites, mais je suis très discrète sur ce plan.
18- Tu as des projets en cours, j’imagine. Nous dirais-tu lesquels ?
Je viens de terminer un travail très ardu, mais qui m’a passionnée : j’ai coordonné un chapitre sur le traducteur au XXe siècle, précisément pour le volume de Histoire des traductions en langue française, XXe siècle à paraître chez Verdier en 2017. Quelque 25 contributeurs (de toute la francophonie) et en tout 150 pages. Pour le traducteur le XXe siècle est le temps de l’épanouissement total, de l’émergence d’une vie associative, d’une amélioration considérable de son statut. Il y avait donc beaucoup à dire.
Pour le reste : je vais travailler à la traduction d’un grand roman hongrois avec une amie hongroise, et à deux, nous allons tenter de restituer avec fidélité ce texte magnifique… dont je garde encore le titre et l’auteur secrets…
Et enfin, je prépare ma participation à un congrès mondial de traductologie (organisé par SEPTET)… où j’organise et dirige une session de 8 ateliers ! C’est un congrès mammouth en effet.
(organisé par SEPTET)… où j’organise et dirige une session de 8 ateliers ! C’est un congrès mammouth en effet.
Et puis bien sûr je continue à porter à bout de bras mes deux enfants adorés : le Centre Européen de traduction littéraire (CETL), qui connaît un énorme succès (notamment par ses cours à distance) et le Collège des traducteurs de Seneffe où j’organise mes salons littéraires et mes échanges interculturels et interhumains d’année en année depuis 20 ans.
Voilà donc pour l’avenir immédiat…

J’ai eu l’immense bonheur de suivre les cours de traduction de Madame Wuilmart à l’institut Lucien Cooremans à Bruxelles dans le cadre de ma licence dans les années 80. Son cours était passionnant, elle avait l’art de communiquer son enthousiasme et son amour de la langue allemande. Plus de 30 ans plus tard, j’y pense souvent et mon souvenir est très vivace. Je lis beaucoup de livres en allemand, son apprentissage y est pour quelque chose. Merci encore. Marie-Claire Achenne
J’ai eu la chance de suivre ses cours de traduction littéraire à l’ISTI. Je peux dire qu’ils furent essentiels pour mon épanouissement intellectuel.
Où l’on découvre la dimension sensuelle de la traduction…
Merci pour ce pasionnant article… Comme toujours 😀
Formidable ! quand on se passionne pour un auteur étranger, on relève rarement le nom du traducteur ! pourtant sans lui … cette interview, quelle belle école d’humilité: « la liberté c’est de parler avec la pensée des autres » dit en substance Jean-Pierre Léaud dans « La Maman et la Putain » … Quand un texte est « magnifique » on imagine le bonheur du traducteur: sait-on le nombre de traductions, dans la même langue, de Madame Bovary ? 19 répertoriées en japonais ! une vingtaine aussi en anglais (dont celle, la première, d’Eléonor, la fille de Karl Marx !)
A lire l’interview de Françoise Wuilmart, on fond d’admiration devant ce pétillement d’intelligence ! merci les traducteurs ! ambroise perrin
Merci pour votre enthousiasme qui fera chaud au coeur de tous les traducteurs !
Formidable ! quand on se passionne pour un auteur étranger, on relève rarement le nom du traducteur ! pourtant sans lui … cette interview, quelle belle école d’humilité: « la liberté c’est de parler avec la pensée des autres » dit en substance Jean-Pierre Léaud dans « La maman et la Putain » … Quand un texte est « magnifique » on imagine le bonheur du traducteur: sais-t-on le nombre de traductions, dans la même langue, de Madame Bovary ? 19 répertoriées en japonais ! une vingtaine aussi en anglais (dont celle, la première, d’Eléonor, la fille de Karl Marx !)
A lire l’interview de Françoise Wuilmart, on fond d’admiration devant ce pétillement d’intelligence ! merci les traducteurs ! ambroise perrin
Bravo pour cette interview absolument passionnante qui est une véritable source d’inspiration. Traduire, enseigner la traduction de façon si originale, écrire aussi : quel programme magistral !